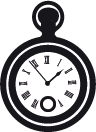L’aide publique en temps de crises : se replier ou coopérer ?
Par Oumou Zé, Chargée de recherche au CNCD 11.11.11
La coopération internationale est en péril. En Europe, qui reste malgré tout le premier donateur mondial, les montants de l’aide publique au développement (APD) ont baissé pour la première fois depuis 2007[1]. La Belgique ne fait pas exception. En temps de crises, la tendance est à la restriction budgétaire, au recul. Le spectre de la pauvreté plane sur les européens également. Les fermetures d’entreprises et la remise en cause des acquis de l’État-providence sont autant d’arguments pour dire combien les temps sont difficiles. La coopération au développement doit être redéfinie, en tenant compte aussi de la place qu’occupent les pays émergents dans les débats globaux, leur forte croissance économique et leur présence accrue sur le terrain de la coopération.
Dans un contexte des relations internationales en profonde mutation, les défis globaux s’accentuent et les crises locales s’approfondissent. Ces dernières années, à l'échelle mondiale, l’effort politique et l’implication financière pour la coopération au développement ont été mis sous pression. La coopération au développement belge est soumise aux arbitrages internes au gouvernement, dans une ambiance d’austérité. « Aider nos pauvres d’abord », la formule jusqu’alors si peu politiquement correcte, commence à se décomplexer, pendant que l’ambiance est à la peur et le sentiment d’insécurité est renforcé.
Du point de vue politique, le dialogue international est difficile. Les dernières rencontres et sommets internationaux ont peiné à aboutir sur des accords ou engagements mutuels. Que ce soit pour le commerce, le climat, l’aide ou le développement durable, l’entente est difficile, et l’échec des négociations quasi-systématique. Dès lors, le plus grand défi posé à la communauté internationale en proie aux crises multiples, sera de démontrer sa capacité à poursuivre le dialogue et la coopération. La capacité à ne pas céder aux tentations de repli.
La coopération et la logique de la lutte contre la pauvreté
Analyser la coopération au développement, ses politiques et ses instruments c’est un travail continu sur les moyens mis à dispositions par un pays, en vue d’atteindre des objectifs de développement déterminés. Au-delà des moyens, financements et modalités, la société civile doit pouvoir jouer son rôle de veille et d’interpellation, en questionnant les visions et les objectifs qui façonnent les politiques de coopération.
La Belgique, comme bon nombre de pays donateurs du Comité d’Aide de l’OCDE (CAD), inscrit son action de coopération au développement dans une logique de lutte contre la pauvreté. Au tournant du millénaire, et dans la foulée de l’engouement pour un set d’indicateurs synthétiques et symboliques, la stratégie adoptée par la Belgique fut l’actualisation d’une note politique sur le sujet. Cet engagement pour la lutte contre la pauvreté se situe d’ailleurs dans une période particulière. On assiste à l’institutionnalisation pour la première fois, du consensus sur la nécessité d’éradiquer la pauvreté [2]. Se pose dès lors la question de savoir s’il est pertinent, nécessaire et efficace d’institutionnaliser des accords internationaux, comme condition pour avancer sur des défis communs. Il est évident que ce ciblage collectif de la pauvreté comme objectif central de la coopération au développement a marqué les choix stratégiques de la plupart des pays donateurs.
En Belgique, la loi formulée en 1999 qui encadrait l’action du gouvernement en matière de coopération internationale se fondait en effet sur cet objectif. La « loi relative à la coopération au développement » adoptée le 19 mars 2013 met à jour la vision politique en la matière. Désormais, le « développement humain durable », basé sur la défense et le respect des trois générations de Droits humains tels que définis dans les pactes des Nations Unies en la matière, constitue l’objectif général de la Coopération belge au Développement.
Si la priorité de la lutte contre la pauvreté fait l’objet d’un consensus dans l’esprit de la Déclaration du Millénaire, des critiques ont toutefois été rapidement formulées. Très vite, les organisations de développement de la société civile se sont exprimées[3] : une des premières limites des OMD résidait justement dans le fait d’isoler chaque objectif en fonction de la thématique, et de les assortir de cibles purement quantitatives. En effet, la plupart des domaines identifiés sont en réalité dans une relation systémique. Les réussites dans l’un doivent pouvoir soutenir les progrès dans l’autre, et inversement les freins ont un effet domino quasi systématique.
Ainsi le set d’OMD faisait le pari d’avancer sur des objectifs sociaux essentiellement, en quantifiant l’atteinte de résultats dans les pays en développement. La stratégie pour atteindre ces objectifs ne faisant quant à elle pas l’objet d’une vision partagée [4]. C’est pourquoi une erreur fondamentale a consisté à faire de l’outil qui doit mesurer les actions une fin en soi. Le ciblage sur quelques indicateurs quantitatifs, notamment dans le cas de l’OMD 1 (éliminer l’extrême pauvreté et la faim, et réduire de moitié, à 2015, la proportion de la population mondiale dont le revenu est inférieur à un dollar par jour, qui souffre de la faim et qui n’a pas accès à l’eau potable) et de l’OMD 2 (assurer l’éducation primaire pour tous), ne doit en effet pas être découplé d’une dimension politique forte, de principes partagés sur la vision du développement.
Comment, par exemple, se donner pour objectif la diminution de la proportion de personnes sous le seuil de pauvreté absolue, sans considérer la question des inégalités qui maintient dans une pauvreté relative ? De la même manière que l’éducation doit être considérée comme un moyen d’apporter une émancipation et de contribuer au développement, la batterie institutionnelle mise en place pour atteindre l’OMD 2 ne doit pas constituer la fin en soi.
Dans une étude diagnostique sur les Objectifs du millénaire et l’éducation en Afrique, réalisée pour le Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale (CWBCI), le CNCD-11.11.11 mettait déjà en évidence en 2006 le biais qui consiste à se concentrer sur la réalisation quantitative (construction de classes, décompte du nombre d’enfants scolarisés par exemple), au détriment de l’objectif qualitatif individuel et collectif (améliorer l’offre éducative afin que le parcours de scolarité contribue aux perspectives de développement)[5].
Ce nouveau cadre international va pourtant fort influencer la façon dont les gouvernements des « pays donateurs » vont penser, mettre en œuvre et justifier leur coopération au développement. Le caractère synthétique, et compréhensible d’un large public ayant contribué pour beaucoup à cet engouement. En Belgique, cela s’est traduit par la mise en place d’un exercice de suivi et d’évaluation des résultats atteints, qui utilise le cadre de référence des OMD.
Mais en amont, un certain engagement politique est formulé dans des notes de politiques intermédiaires, en 2009 et en 2010. Ainsi depuis 2006 un rapport annuel est élaboré et présenté devant le Parlement fédéral, afin de rendre compte de la « contribution belge à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement ». Il se trouve que cet exercice de rapport constitue l’un des seuls moments de bilan plus transversal, qui soit produit par la coopération belge. On y prend alors connaissance d’une certaine auto-évaluation de la coopération belge, même si cela n’en n’est pas le lieu officiel et attitré.
Sont ainsi épinglées la contribution accrue pour l’agriculture et l’alimentation, avec l’objectif d’atteindre 15% de l’APD consacrée à cette priorité sectorielle en 2015, et la concentration sur l’éducation et la formation au niveau supérieur en priorité, avec 12% du budget[6].Toutefois, la contribution belge pour l’OMD 7 relatif à l’environnement durable n’est pas à la hauteur des ambitions déclarées. Alors qu’elle s’est engagée à contribuer pour 150 millions d’euros à l’alimentation du mécanisme de financement rapide « Fast Start », elle n’en a engagé que 90 millions au bout des trois années de la période initialement prévue.
Parallèlement, la Belgique a opté pour un renforcement de son rôle dans la concertation au sein des organisations multilatérales. Ainsi les contributions belges aux agences des Nations Unies, par exemple, sont quasi systématiquement faites aux budgets généraux. Ce faisant, la Belgique désire pouvoir jouer un rôle accru dans les discussions stratégiques. Toutefois une interpellation constante de la société civile belge consiste à rappeler l’importance d’améliorer la cohérence de l’ensemble des décisions politiques belges, au-delà de la seule politique de coopération.
En effet, déjà lors de la revue par les pairs du CAD de l’OCDE en 2010, des recommandations allaient dans ce sens[7]. Aux côtés des différentes initiatives qui visent à améliorer l’efficacité de son aide, il est impératif que le gouvernement belge dans son ensemble se donne les moyens de rendre tous ses domaines d’action cohérents entre eux. Ne pas contrecarrer l’atteinte des objectifs de la coopération au développement par des mesures commerciales, financières ou migratoires par exemple. Ne pas reprendre d’une main ce que l’on a donné de l’autre. Il est d’ailleurs marquant que ledit rapport belge sur la contribution aux OMD ne s’arrête qu’à la coordination entre les différents canaux de l’aide publique (cohérence interne), en lieu et place d’une mise en question de la cohérence entre les différentes compétences, au-delà de la coopération (cohérence pangouvernementale).
Penser l’efficacité du développement en ces termes de cohérence des politiques, c’est inévitablement se soumettre à un exercice d’autocritique et de dialogue sur l’ensemble de ses pratiques. Dès lors, le défi majeur posé à la communauté internationale, sa capacité à rester en dialogue constitue certainement la priorité. De plus en plus d’analyses et de propositions commencent à émerger de toutes parts quant à la vision du développement au-delà de 2015 : organisations internationales, gouvernements, organisations de la société civile. Une des questions fondamentales sera celle d’arriver à maintenir une vision commune, à la traduite en accord, au moyen de mesures opérationnelles et à s’adresser à tous dans un esprit de responsabilités partagées. Une autre limite souvent relevée au sujet des OMD était la limitation aux pays en développement. Depuis lors, et notamment dans le cadre des réflexions qui ont entouré le sommet de Rio+20, il est évident que les défis globaux appellent à ce que des objectifs communs soient identifiés. La Belgique a d’ailleurs montré une forte implication dans les négociations sur le développement durable. Il est à espérer qu’elle maintienne ses ambitions pour la défense d’une dimension sociale forte pour le futur cadre international d’après 2015.
Engager la discussion, accepter de coopérer en vue d’entamer véritablement une transition socio-écologique juste et équitable. Telle est l’alternative qui s’impose, en permettant à chaque partie prenante, individuelle ou collective, de participer et prendre ses responsabilités. Pour ce faire, « l’éradication de la pauvreté et des inégalités sociales et de genre, la remise en question de nos modes de production et de consommation et la préservation des ressources et des services »[8] sont les composantes incontournables du futur cadre international de développement en devenir.
Notes :
[1] Développement : l’aide aux pays en développement fléchit sous l’effet de la récession mondiale, Communiqué de presse du CAD de l’OCDE, 4 avril 2012
[2] Sakiko Fukuda-Parr, Should global goal setting continue, and how, in the post-2015 era ?, (New York: United Nations DESA, July 2012), 24 p.
[3] Voir notamment à ce sujet : Aurélie Leroy, Potentialités et limites des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Tour d’horizon dans six pays du Sud, (Louvain-la-Neuve, Septembre 2006), 35p.
[4] Ibidem
[5] Arnaud Zacharie, Marta Ruiz, Oumou Zé et Francisco Padilla, Les Objectifs du millénaire et l’éducation en Afrique : Etude diagnostique sur la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, le Burkina Faso et le Maroc, (Bruxelles : CWBCI, 2006), 175p.
[6] Rapport annuel 2010, (Bruxelles : DGD, 2011), 112 p.
[7] Oumou Zé, Arnaud Zacharie et al. L’aide en temps de crises : repli ou coopération ? Rapport 2012 sur l’aide belge au développement, (Bruxelles, CNCD-11.11.11 : 2012), 45p.
[8] Véronique Rigot, Rio+20 : L’abîme ou la métamorphose ?, IN Point Sud N°6, (Bruxelles, Mai 2012), 44p.